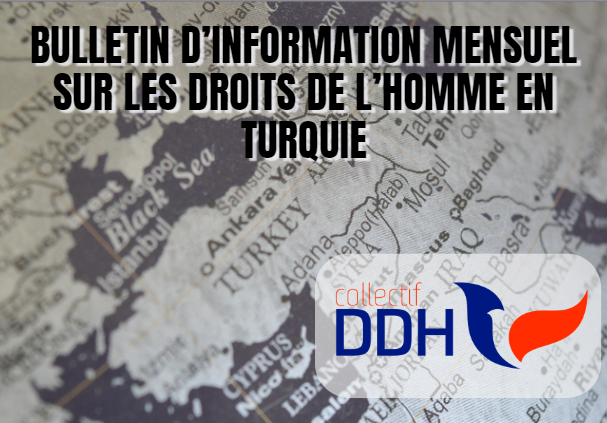LE RAPPORT DE HUMAN RIGHTS WATCH POUR L’ANNEE 2019 SUR LA TURQUIE

La Turquie connaît une crise des droits de l’Homme sans précèdent, s’aggravant au cours des quatre dernières années avec une érosion dramatique de son cadre de l’État de droit et de la démocratie. Alors que la consolidation du pouvoir incontrôlé du président Recep Tayyip Erdoğan se poursuit, les élections locales du 31 mars 2019 ont vu son Parti de la justice et du développement (AKP) allié à l’extrême droite perdre dans les grandes villes comme Istanbul et Ankara, malgré le fait qu’il ait remporté 51% des voix à l’échelle nationale. Le candidat de l’opposition Ekrem İmamoğlu a massivement renforcé sa victoire serrée à Istanbul lors d’une répétition de l’élection du 23 juin, autorisée de façon controversée par le Conseil supérieur des élections sans motif légitime.
Le contrôle exécutif et l’influence politique sur le pouvoir judiciaire en Turquie ont conduit les tribunaux à systématiquement accepter de faux actes d’accusation, à détenir et à condamner des individus et des groupes que le gouvernement Erdoğan considère comme des opposants politiques sans preuves convaincantes sur l’action criminelle. Parmi ceux-là, figurent des journalistes, des politiciens de l’opposition, des militants et des défenseurs des droits de l’homme. Le groupe le plus important est constitué de personnes qui auraient des liens avec le mouvement dirigé par l’ecclésiastique sunnite Fethullah Gülen, basé aux États-Unis, que le gouvernement accuse d’avoir organisé la tentative de coup d’État de juillet 2016.
Le 9 octobre, suite au retrait des troupes américaines dans la région, la Turquie a occupé le territoire du nord-est de la Syrie, aidée par des acteurs non étatiques syriens. La Turquie a indiqué que son principal objectif était de retirer les forces et l’administration kurdes qui contrôlaient la région en raison de leurs liens étroits avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) armé avec lequel la Turquie était engagée dans un conflit qui dure depuis des décennies (voir le chapitre sur la Syrie).
Après l’état d’urgence
Les pouvoirs et pratiques restrictifs qui prennent fin en juillet 2018 ont fait reculer le bilan de la Turquie en matière de droits de l’homme.
Les accusations de terrorisme ont continué d’être largement abusées au cours de la troisième année après la tentative de coup d’État. En juillet 2019, les chiffres du ministère de la Justice indiquaient que la procédure pénale des 69 259 personnes étaient en cours et 155 560 personnes étaient toujours sous enquête criminelle pour terrorisme dans des affaires liées au mouvement Gülen, que le gouvernement turc appelle l’Organisation terroriste fethullahiste (FETÖ) et considère comme une organisation terroriste. Parmi ceux-ci, 29 487 étaient en détention provisoire ou détenus après condamnation. Bien que les chiffres officiels n’aient pu être obtenus, on estime que 8 500 personnes – y compris des politiciens élus et des journalistes – sont en détention provisoire ou détenues à la suite d’une condamnation pour des liens prétendues avec le Parti illégale des travailleurs du Kurdistan (PKK / KCK). Il s’agit en outre de plusieurs d’autres en libertés mais leur procédure pénale est en cours.
Suite à l’octroi de pouvoirs supplémentaires aux gouverneurs provinciaux en juillet 2018, et afin de restreindre les déplacements et les assemblées dans leurs provinces en se référant aux vagues préoccupations d’ordre public et de sécurité, des restrictions sévères concernant le droit de réunion ont eu lieu en Turquie. Cela a affecté de manière disproportionnée les manifestations dans ou concernant principalement le sud-est kurde et les rassemblements de groupes lesbiens, gays, bisexuels ou transgenres (LGBT) dans tout le pays.
Le 25 octobre 2019, la commission, créée en 2017 pour examiner les expulsions massives de fonctionnaires dans le cadre de l’état d’urgence, avait rendu des décisions dans 92 000 cas (dont 8 100 ont été réintégrés dans leur emploi ou des mesures de réparation similaires ont été adoptés) et 34 200 autres cas restent à être examinés. Les appels contre ces décisions s’avancent lentement devant deux tribunaux administratifs d’Ankara.
Les procès des militaires et d’autres personnes impliquées dans la tentative de coup d’État de juillet 2016, faisant état de 250 morts, se sont poursuivis. En juillet, selon les chiffres du ministère de la Justice, 3 611 accusés ont été condamnés et 2 608 acquittés. La Cour de cassation a commencé à confirmer des verdicts dans certains cas et de nombreux recours sont pendants.
Le paquet d’amendements à la réforme judiciaire de la présidence d’Erdoğan adopté par le Parlement en octobre a modifié diverses lois. Mais celui-ci étant trop généralisé et vague n’a pu aboutir à de véritables mesures pour remédier aux lacunes profondes et omniprésentes du système judiciaire turc.
Liberté d’expression, d’association et de réunion
Au moment de la rédaction de ce rapport, on estime que 119 journalistes et salariés des médias sont en détention provisoire ou purgent des peines pour des crimes tels que la « diffusion de propagande terroriste » et « appartenance à une organisation terroriste ». Les procédures sont pendantes à l’encontre des centaines d’autres journalistes qui ne sont pas détenus. La plupart des médias, y compris la télévision, se conforment à la ligne politique de la présidence Erdogan.
Malgré la décision de la Cour de cassation d’annuler les condamnations de 13 journalistes et cadres du quotidien Cumhuriyet, lors de leur nouveau procès en novembre, le tribunal de première instance d’Istanbul s’est opposé à la cour suprême en les condamnant une fois de plus pour « aide et complicité avec des organisations terroristes ». La cour d’assises d’Istanbul a infligé les mêmes peines de prison qu’elle a prononcées lors de leur premier procès, allant de près de quatre ans à plus de huit ans, mais cette fois-ci, le journaliste Kadri Gürsel a été acquitté. Tous les détenus sont remis en liberté après avoir passé de longues périodes en prison. Ils interjettent appel contre les décisions de condamnations.
Après avoir été reconnu coupable et condamné à dix ans et six mois d’emprisonnement pour « aide et complicité avec des organisations terroristes », l’écrivain-journaliste Ahmet Altan a d’abord été libéré après plus de trois ans de détention provisoire. Lors de son nouveau procès en novembre, il a été détenu à nouveau une semaine plus tard après qu’une cour d’Istanbul eut annulé la décision. La procédure engagée contre Altan a été arbitraire dans sa totalité et démontre une forte ingérence politique de l’exécutif.
Les journalistes travaillant pour les médias kurdes en Turquie continuent d’être pris pour cible de manière disproportionnée et les reportages critiques en provenance du sud-est du pays sont soumis à de sévères restrictions.
Un règlement du mois d’août permet la diffusion régulière sur Internet soumis à l’autorité officielle de régulation des médias en Turquie, le Conseil suprême de la radio et de la télévision (RTÜK). Cela signifie que les émissions d’informations via YouTube, les plateformes telles que Netflix, les médias sociaux diffusés via Periscope et d’autres plateformes, seront toutes soumises à l’inspection et aux sanctions du RTÜK, telles que la suspension du contenu si elles sont jugées contraires aux lois turques. Les diffuseurs Internet doivent obtenir des licences pour diffuser en Turquie même s’ils opèrent depuis l’étranger tout en sachant que la violation des lois peut entraîner leur suspension. Les groupes de défense des droits craignent que la nouvelle réglementation n’entraîne des censures plus sévères.
Les autorités continuent de bloquer les sites internet et d’ordonner la suppression du contenu en ligne tandis que des milliers de personnes en Turquie font face à des enquêtes pénales, des poursuites et des condamnations pour leurs publications sur les réseaux sociaux. Depuis la première élection d’Erdoğan comme président en 2014, le nombre de poursuites et de condamnations pour « insulte au président » a augmenté de façon spectaculaire. Le Wikipedia continue d’être bloqué en Turquie depuis avril 2017.
En juillet, la Cour constitutionnelle a décidé que les droits des universitaires ayant signé une pétition en janvier 2016 avaient été violés. Des poursuites ouvertes contre 822 universitaires ont abouti à des centaines de condamnations pour « diffusion de propagande terroriste » notamment pour avoir critiqué les opérations militaires du gouvernement dans le sud-est et appelé à un processus de paix. La décision de la Cour constitutionnelle a conduit à l’acquittement des universitaires.
Un tribunal d’Istanbul a condamné le président départemental d’Istanbul du Parti républicain du peuple (CHP), Canan Kaftancıoğlu, à neuf ans et huit mois d’emprisonnement pour avoir publié des messages sur les médias sociaux entre 2012 et 2017, notamment pour avoir insulté le président. La condamnation était en appel au moment de la rédaction de ce rapport, mais si elle est confirmée, elle pourrait se voir interdire toute activité politique et être emprisonnée. Le procès contre Kaftancıoğlu s’inscrit dans un schéma de harcèlement des politiciens de l’opposition.
Défenseurs des droits humains
Le ciblage des défenseurs des droits humains s’est accéléré avec l’ouverture en juin d’un procès contre Osman Kavala, homme d’affaires et leader de la société civile. Kavala est en détention provisoire depuis novembre 2017. Avec 15 autres personnes engagées dans l’activisme pacifique et les arts, il est accusé d’avoir organisé et financé les manifestations massives du parc Gezi à Istanbul en 2013. Ne présentant aucune preuve d’activité criminelle, l’acte d’accusation contre ces 16 personnes dénigre également le philanthrope américain George Soros et affirme que ce dernier a organisé les manifestations de Gezi. Yiğit Aksakoğlu, défenseur des droits et détenu depuis novembre 2018, a été libéré lors de l’audience de juin. Le procès se poursuivait au moment de la rédaction du présent rapport.
Le procès de neuf éminents défenseurs des droits humains turcs et de deux ressortissants étrangers se poursuit. Tous ont été arrêtés et inculpés en 2017 pour infractions liées au terrorisme. Parmi eux figurent le président d’honneur d’Amnesty International Turquie, Taner Kılıç, qui a passé plus d’un an en détention, ainsi que l’ancienne directrice İdil Eser.
Les poursuites et les condamnations d’avocats, dont certains étaient spécialisé sur les droits humains, sont apparues comme un exemple de recours abusif aux accusations de terrorisme. En mars, un tribunal d’Istanbul a condamné Selcuk Kozağaçlı, avocat à Ankara et président de l’Association des avocats contemporains qui avait été fermée, à une peine de prison de plus de 11 ans pour appartenance à une organisation armée, ainsi que 11 autres avocats. Au moment de la rédaction du présent rapport, la procédure judiciaire était en appel.
Il n’y a pas eu d’enquête effective jusqu’à ce jour sur la fusillade meurtrière du 28 novembre 2015 de Tahir Elçi, avocat des droits humains.
En avril, un tribunal à Ankara a levé l’interdiction générale du gouverneur d’Ankara, en vigueur depuis novembre 2017, concernant les événements publics organisés par des groupes de défense des droits des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT). Cependant, l’interdiction de ces événements à Ankara et dans d’autres villes de Turquie se poursuit de manière systématique, ce qui témoigne d’une approche répressive des droits des LGBT. La marche annuelle de la fierté a été interdite à Istanbul pour la cinquième année consécutive, ainsi que d’autres villes comme Antalya ou Izmir.
La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les militants des droits des femmes qui participaient, le 8 mars à Istanbul, à la manifestation de la Journée internationale de la femme pour protester contre le problème endémique de la violence faites aux femmes en Turquie.
Torture et mauvais traitements en détention, enlèvements.
L’augmentation des allégations de torture et de mauvais traitements ainsi que d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants durant la période de garde à vue et en prison au cours des quatre dernières années a fait reculer les progrès préexistants de la Turquie dans ce domaine. Les personnes visées sont notamment des Kurdes, des militants de gauche et des partisans présumés du mouvement de Gülen. Les procureurs ne mènent pas d’enquêtes significatives sur ces allégations et il existe une culture omniprésente d’impunité pour les membres des forces de sécurité et les fonctionnaires impliqués.
Le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) a effectué deux visites dans des lieux de détention en Turquie depuis la tentative de coup d’État, l’une en mai 2019, cependant le gouvernement turc n’a pas autorisé la publication des rapports de ces deux visites.
Six hommes ont été enlevés en février et un en août dans des circonstances qui pourraient être assimilées à des disparitions forcées par des agents de l’État, six ayant fait surface en garde à vue des mois plus tard, puis placés en détention provisoire, mais n’ont pas pu voir les avocats envoyés par les familles.
Les autorités turques ont continué à demander des pays du monde entier l’extradition des partisans présumés de Gülen, dont beaucoup d’enseignants. Les pays qui se sont conformés aux demandes de la Turquie ont contourné les procédures légales et le contrôle judiciaire. Les personnes ainsi illégalement extradées ont été détenues et poursuivies à leur retour en Turquie.
Conflit kurde et répression de l’opposition
Des affrontements armés sporadiques entre l’armée et le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), parti armé, se sont poursuivis dans le sud-est jusqu’en 2019, principalement dans les zones rurales. Une fois de plus, le gouvernement d’Erdoğan a refusé d’établir une distinction entre le PKK et le Parti démocratique du peuple (HDP) démocratiquement élu, qui a remporté 11,9 % des voix nationales lors des dernières élections législatives.
En août, le ministère de l’Intérieur a démis de leurs fonctions les maires du HDP des grandes municipalités de Diyarbakır, Van et Mardin, nouvellement élus à la majorité des voix lors des élections municipales du 31 mars, les accusant, sur la base d’enquêtes et de poursuites criminelles en cours, de liens avec le terrorisme. À la place des maires choisis par les électeurs, le ministère de l’Intérieur a nommé des gouverneurs provinciaux comme » administrateurs » pour qu’ils gèrent les municipalités et a dissous le conseil municipal, suspendant ainsi la démocratie locale dans chaque ville. Dans les mois qui ont suivi, la destitution d’autres maires élus par le HDP dans les circonscriptions de la région s’est poursuivie : 24 d’entre eux étaient destitués au moment de la rédaction du présent rapport et 14, dont Adnan Selçuk Mızraklı, maire de Diyarbakir, étaient emprisonnés dans l’attente d’une enquête et d’un procès.
Les affaires contre les politiciens du HDP sont la preuve la plus flagrante que les autorités engagent des poursuites pénales et utilisent la détention à des fins politiques et de mauvaise foi. La Turquie ne s’est pas conformée à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme de 2018 ordonnant la libération de l’ancien coprésident du HDP, Selahattin Demirtaş, et a fait appel devant la Grande Chambre de la Cour. Trois jours après l’audience de la Grande Chambre en septembre, le président Erdoğan a déclaré qu’il ne laisserait pas Demirtaş ou son coprésident Figen Yüksekdağ sortir de prison. La Cour européenne des droits de l’homme devrait rendre sa décision au cours du premier semestre 2020.
Les réfugiés et les migrants
La Turquie accueille le plus grand nombre de réfugiés au monde, environ 3,7 millions en provenance de Syrie. Elle accueille également des demandeurs d’asile en provenance d’Afghanistan, d’Irak et d’autres pays. Le gouverneur d’Istanbul a annoncé en juillet que les Syriens et les autres personnes non enregistrées à Istanbul seraient transférés vers d’autres provinces. Les autorités turques ont illégalement expulsé certains Syriens d’Istanbul et d’autres provinces vers la Syrie, notamment après avoir contraint certains d’entre eux, par la violence, les menaces verbales et la menace d’une détention illimitée, à signer des formulaires de retour volontaire. La frontière avec la Syrie reste fermée aux nouveaux demandeurs d’asile. Le président Erdoğan a déclaré à plusieurs reprises que les Syriens en Turquie devraient être réinstallés dans une zone sûre au nord-est de la Syrie.
Acteurs-clés internationaux
La relation politique de la Turquie avec l’Union européenne et ses États membres reste limitée, bien qu’elle maintienne que son objectif déclaré est d’adhérer à l’UE. Cette dernière a reconnu, dans diverses déclarations et dans son rapport de suivi de mai, le climat négatif qui règne en Turquie. Elle a condamné l’incursion militaire de la Turquie dans le nord-est de la Syrie, tout en mettant l’accent sur son accord migratoire avec la Turquie. Le Conseil de l’UE a noté, en juin, que » la Turquie s’éloigne de plus en plus de l’Union européenne « .
Les relations américano-turques se sont encore dégradées avec l’acquisition par la Turquie en 2019 de missiles russes S-400, un développement sans précédent pour un Etat membre de l’OTAN. Des tensions subsistent sur d’autres aspects tels que l’incursion militaire de la Turquie en octobre dans le nord-est de la Syrie, les poursuites abusives de la Turquie contre trois membres du personnel consulaire américain qui sont des ressortissants turcs, dont l’un est resté en détention, et la présence sur le sol américain de Fethullah Gülen.
La Cour européenne des droits de l’homme a statué en avril que l’ancien membre de la Cour constitutionnelle Alpaslan Altan avait été injustement privé de sa liberté parce qu’il n’y avait pas de soupçon raisonnable pour justifier sa première arrestation après la tentative de coup d’État de juillet 2016. Dans une décision de septembre concernant de nombreux prisonniers détenus loin de leur famille, la Cour européenne a estimé que le transfert vers des prisons éloignées constituait une violation du droit au respect de la vie privée et familiale.