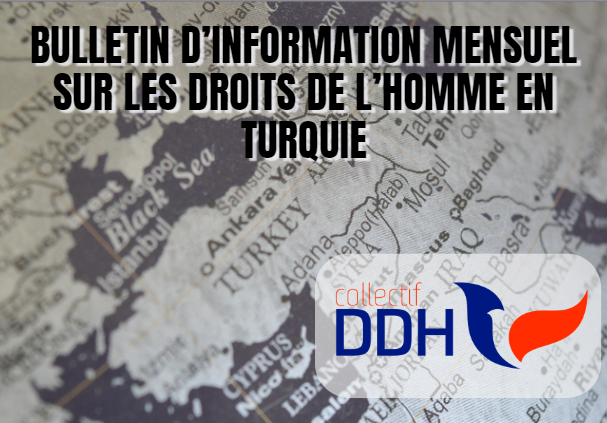Le Rapport de Human Rights Watch pour l’annee 2018 sur la Turquie
La campagne électorale de juin 2018 s’est déroulée dans le cadre de l’état d’urgence imposé après la tentative de coup d’État militaire de juillet 2016 et dans un climat de censure des médias et de répression des ennemis du gouvernement et des détracteurs présumés qui ont persisté tout au long de l’année. Plusieurs journalistes, parlementaires et journalistes ont été persécutés. Le candidat à la présidence de l’opposition pro-kurde en prison.
L’élection a mis en vigueur le système de gouvernement présidentiel convenu lors du référendum de 2017. Le système manque de contrôles et d’équilibres suffisants contre les abus du pouvoir exécutif, diminue considérablement les pouvoirs du parlement et renforce le contrôle présidentiel sur la plupart des nominations à la magistrature.
En janvier 2018, la Turquie a lancé une offensive militaire dans le district d’Afrin, peuplée de Kurdes et peuplée de Syriens du nord-ouest. Au moment de la rédaction du présent rapport, elle continuait de contrôler le territoire.
État d’urgence et après l’état d’urgence
L’état d’urgence de deux ans a officiellement expiré en juillet 2018 mais a été remplacé par une nouvelle législation antiterroriste, approuvée par le Parlement en août. La législation contient de nombreuses mesures similaires aux pouvoirs extraordinaires dont jouissent les autorités en vertu de l’état d’urgence. Il s’agit notamment de l’élargissement des pouvoirs déjà étendus des gouverneurs provinciaux nommés pour restreindre les assemblées et les déplacements ; du pouvoir exécutif, pendant trois ans, de révoquer les fonctionnaires, y compris les juges, par décision administrative ; et de pouvoirs policiers accrus, y compris des périodes de détention pouvant être prolongées de 12 jours au maximum.
La commission chargée d’examiner le licenciement de plus de 130 000 fonctionnaires pour association présumée avec des groupes terroristes a poursuivi ses travaux. La plupart seraient associés au mouvement religieux Fethullah Gülen que le gouvernement et les tribunaux accusent d’être à l’origine de la tentative de coup d’État et considèrent comme une organisation terroriste (FETÖ).
Au moment de la rédaction du présent rapport, la Commission, créée en 2017 sur avis du Conseil de l’Europe, avait rendu des décisions dans 36 000 cas, dont 2 300 avaient été réintégrés dans leurs fonctions ou avaient bénéficié de mesures de réparation similaires, et au moins 88 660 autres recours en révision.
Les accusations de terrorisme ont continué d’être largement utilisées. En juin, près d’un cinquième (48 924) de la population carcérale totale (246 426) avait été accusé ou condamné pour des infractions terroristes, selon le Ministère de la Justice. Parmi les personnes poursuivies et condamnées figuraient des journalistes, des fonctionnaires, des enseignants et des hommes politiques, ainsi que des officiers de police et du personnel militaire.
Sur ces 48 924 personnes, 34 241 étaient détenues pour des liens présumés avec le Gulenist (FETÖ), 10 286 pour des liens présumés avec le Kurdistan Workers’ Party (PKK) et 1 270 pour des liens présumés avec le groupe extrémiste de l’État islamique (ISIS).
De nombreux procès pour terrorisme en Turquie n’ont pas de preuves convaincantes d’activités criminelles ou d’actes qui pourraient raisonnablement être considérés comme des actes terroristes, et la pratique consistant à placer en détention provisoire prolongée les personnes accusées d’infractions terroristes est devenue une forme de peine sommaire.
Les procès se sont poursuivis contre des militaires et d’autres personnes pour leur participation à la tentative de coup d’État de juillet 2016, au cours de laquelle 250 personnes ont trouvé la mort. En juin, 2 177 prévenus avaient été condamnés et 1 552 acquittés en première instance, selon le Ministère de la justice. Il n’y avait pas de verdicts définitifs au moment de la rédaction du présent rapport.
Liberté d’expression, d’association et de réunion
La Turquie reste le leader mondial de l’incarcération des journalistes. Au moment de la rédaction du présent rapport, on estime que 175 journalistes et professionnels des médias sont en détention provisoire ou purgent des peines pour des délits de terrorisme. Des centaines d’autres sont en procès mais en liberté.
La plupart des médias manquent d’indépendance et promeuvent la ligne politique du gouvernement.
Au cours de l’année, les tribunaux ont rendu des verdicts dans plusieurs procès importants de journalistes motivés par des considérations politiques, sur la base d’éléments de preuve consistant en des écrits et des reportages qui ne préconisent pas la violence à côté d’allégations non étayées de liens avec des organisations terroristes ou la tentative de putsch. La plupart des cas sont maintenant en appel.
En février, les écrivains et commentateurs Ahmet Altan, Mehmet Altan et Nazlı Ilıcak ont été condamnés à la réclusion à perpétuité sans libération conditionnelle sur la base de fausses accusations de coup d’État. Un tribunal a renfloué Mehmet Altan en juin, après un arrêt de la Cour constitutionnelle en janvier et un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme en mars ordonnant sa libération. Ahmet Altan et Nazli Ilicak restent emprisonnés. Après que la cour d’appel régionale a confirmé les condamnations le 2 octobre, tous les défendeurs ont fait appel devant la Cour de cassation.
Le procès du personnel du journal Cumhuriyet, y compris des journalistes, des cadres et le rédacteur en chef, a pris fin en avril. Quatorze ont été reconnus coupables de fausses accusations de terrorisme et condamnés à des peines allant de deux à huit ans, et trois ont été acquittés.
Dans une autre affaire, la Cour de cassation a confirmé en septembre la peine de prison prononcée contre Enis Berberoğlu, parlementaire du Parti républicain du peuple (CHP), pour avoir fourni des images vidéo que Cumhuriyet a publiées montrant des armes que la Turquie aurait fournies aux groupes d’opposition syriens, mais a également ordonné sa libération après 16 mois en détention avant jugement.
Les procès de 31 journalistes et professionnels des médias du journal Zaman, qui a été fermé, se sont achevés en juillet avec les écrivains Ahmet Turan Alkan, Şahin Alpay et Ali Bulaç, qui ont passé jusqu’à deux ans en détention provisoire mais étaient en liberté au moment de la rédaction du présent rapport, ont été condamnés à huit ans et neuf mois de prison et Mustafa Ünal et Mümtazer Türköne, qui restent en détention, à dix ans ou six mois.
Des journalistes travaillant pour les médias kurdes en Turquie ont continué d’être arrêtés et emprisonnés à plusieurs reprises, faisant obstacle aux reportages critiques en provenance du sud-est du pays.
Après une descente de police en mars sur le journal pro-kurde Free Democracy (Özgürlükçü Demokrasi), ses journalistes et autres travailleurs ont été arrêtés et ses imprimeries et ses biens ont été remis à l’Etat. Le journal a été fermé par décret en juillet, et 21 imprimeurs et 14 journalistes sont poursuivis dans le cadre de procès distincts. Au moment de la rédaction du présent rapport, 13 imprimeurs et journalistes étaient en détention provisoire.
Le blocage des sites Web et la suppression du contenu en ligne se sont poursuivis, et des milliers de personnes en Turquie ont fait l’objet d’enquêtes et de poursuites pénales pour leurs messages sur les médias sociaux. Wikipédia est restée bloquée en Turquie.
En 2018, il y a eu une augmentation des interdictions arbitraires sur les assemblées publiques, particulièrement évidentes après la fin de l’état d’urgence lorsque les gouverneurs ont assumé des pouvoirs accrus pour restreindre les assemblées.
La police a arrêté des étudiants de grandes universités pour avoir manifesté pacifiquement sur le campus contre l’offensive turque contre l’Afrique et pour avoir brandit des banderoles critiques envers le président. Au moins 18 étudiants ont été placés en détention provisoire pour de telles manifestations et beaucoup d’autres ont été poursuivis pour des crimes tels que la « propagande terroriste » et « l’insulte au président ».
En août, le ministre de l’Intérieur a interdit la longue veillée hebdomadaire pacifique et pacifique organisée en un lieu central à Istanbul par les mères du samedi, des proches de victimes de disparitions forcées cherchant à obtenir des comptes. La police a violemment dispersé et brièvement détenu 27 des organisateurs. L’interdiction d’organiser la vigile au lieu traditionnel était toujours en vigueur au moment de la rédaction du présent rapport. Une veillée des mères du samedi à Diyarbakir a également été interdite, de même que toutes les assemblées publiques organisées par la section de Diyarbakir de l’Association des droits de l’homme à partir de septembre.
Le 15 septembre, la police a arrêté des centaines de travailleurs du bâtiment qui protestaient contre les mauvaises conditions de travail et de vie sur le chantier du troisième aéroport d’Istanbul. Les tribunaux ont ordonné la mise en détention provisoire de 37 personnes, y compris des responsables syndicaux, et six ont été libérées par la suite. Beaucoup d’autres font l’objet d’une enquête criminelle et sont accusés d’infractions telles que l’organisation d’une manifestation non autorisée et la résistance à la dispersion.
Défenseurs des droits humains
Après plus de 13 mois derrière les barreaux, un tribunal d’Izmir a libéré, en août, le président honoraire d’Amnesty International Turquie, Taner Kılıç, de prison. Il est toujours en procès pour de fausses accusations de terrorisme, ainsi que huit autres défenseurs éminents de Turquie et deux ressortissants étrangers travaillant dans le domaine des droits de l’homme arrêtés en juillet 2017 et libérés sous caution par la suite.
Osman Kavala, homme d’affaires et personnalité bien connue de la société civile turque, est en détention provisoire depuis novembre 2017. Au moment de la rédaction du présent rapport, Kavala n’avait été inculpé d’aucun crime, mais l’enquête du procureur s’est élargie en novembre 2018 avec la détention de 13 personnes, dont certaines liées à l’organisation non gouvernementale Kavala, et il a été l’accenta été mis sur leurs activités après les manifestations de masse du parc Gezi à Istanbul en 2013. Douze d’entre eux ont été rapidement libérés, mais au moment de la rédaction du présent rapport, le défenseur des droits humains Yiğit Aksakoğlu a été emprisonné en attendant son procès.
Une campagne de dénigrement médiatique connexe et les commentaires publics du président turc visaient également le philanthrope américain George Soros. L’Open Society Foundation de Soros a annoncé en novembre qu’elle dissoudrait sa fondation turque et cesserait ses activités dans le pays.
Les avocats spécialisés dans les droits de l’Homme figurent parmi plus de 1 500 avocats jugés pour terrorisme au moment de la rédaction du présent rapport. Leurs affaires mettent en évidence l’érosion dramatique des droits des accusés et des garanties d’une procédure régulière en Turquie. En septembre, un tribunal d’Istanbul a libéré sous caution 17 avocats qui avaient passé jusqu’à un an en détention provisoire pour appartenance à un groupe armé de gauche, mais a renversé sa propre décision un jour plus tard, ordonnant l’arrestation de 12 d’entre eux. Au moment de la rédaction du présent rapport, l’affaire était en cours.
En novembre 2017, le gouverneur d’Ankara a interdit aux groupes de défense des droits des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT) d’organiser des manifestations publiques tout au long de l’année 2018, ce qui a inspiré des interdictions d’assemblées et de manifestations dans d’autres villes et révélé la répression croissante des groupes LGBT par la Turquie. En juillet, le gouverneur d’Istanbul a interdit pour une quatrième année la marche annuelle de la Fierté de la ville, invoquant des problèmes de sécurité et d’ordre public.
Torture et mauvais traitements sous garde, enlèvements
Les allégations persistantes de torture, de mauvais traitements et de traitements cruels, inhumains ou dégradants en garde à vue et en prison et l’absence d’enquête sérieuse à leur sujet demeurent très préoccupantes. Ces questions ont été soulevées par le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture dans une déclaration de février.
Il n’y a pas eu d’enquête effective sur les enlèvements de 2017, qui auraient été commis par des agents de l’État, d’au moins six hommes détenus dans des lieux de détention secrets avant leur libération des mois plus tard dans des circonstances qui pourraient constituer une disparition forcée.
Les autorités turques ont continué à demander l’extradition de prétendus partisans de Gülen, dont beaucoup d’enseignants, de pays du monde entier. Sans respecter les garanties d’une procédure régulière, les services de sécurité de pays comme le Kosovo et la Moldova ont coopéré avec des agents turcs au cours de l’année pour appréhender et transférer des citoyens turcs en Turquie où ils ont été détenus et poursuivis.
Conflit kurde et répression de l’opposition
Les affrontements armés entre l’armée et le PKK dans le sud-est du pays se sont poursuivis jusqu’en 2018, principalement dans les zones rurales. Le gouvernement a poursuivi ses mesures répressives à l’encontre des parlementaires élus, des maires et des municipalités des partis pro-kurdes, bien que le Parti démocratique populaire (PDH) ait obtenu 67 sièges parlementaires (11,9 % des voix) lors des élections de juin.
Leyla Güven, députée du HDP en exercice, et neuf anciens parlementaires du HDP sont restés en détention préventive prolongée pour terrorisme à motivation politique, y compris l’ancien co-leader du parti et candidat présidentiel Selahattin Demirtaş. Onze députés ont été destitués de leur siège parlementaire au cours de la période précédant les élections de juin et n’ont pas pu se présenter à nouveau comme candidats.
Dans le sud-est, la suspension de la démocratie locale s’est poursuivie alors que le gouvernement a maintenu le contrôle de 94 municipalités remportées aux élections locales de 2014 par le parti frère du HDP, le Parti des régions démocratiques (DBP). Au moment de la rédaction du présent rapport, 50 co-maires étaient toujours emprisonnés pour terrorisme à motivation politique après leur destitution et l’affectation de personnes nommées par le gouvernement à leurs postes.
Réfugiés et migrants
La Turquie continue d’accueillir le plus grand nombre de réfugiés au monde, soit environ 3,5 millions en provenance de Syrie. La Turquie accueille également des demandeurs d’asile d’Afghanistan, d’Irak et d’autres pays. Un accord de migration avec l’UE qui offre une aide en échange de la prévention de la migration vers l’UE s’est poursuivi. La frontière avec la Syrie est effectivement fermée aux nouveaux demandeurs d’asile. Les gardes-frontières ont intercepté et déporté des milliers de Syriens nouvellement arrivés au cours de l’année et ont parfois tiré sur ceux qui tentaient de traverser. Depuis novembre 2017, 10 provinces ont suspendu l’enregistrement des Syriens qui parviennent à passer les gardes-frontières et à atteindre les villes de Turquie. Les taux de travail des enfants restent élevés et le nombre d’enfants réfugiés et demandeurs d’asile non scolarisés reste élevé. En septembre, la Turquie a assumé l’entière responsabilité du traitement des demandes d’asile. Mais les autorités n’accordent pas le statut de réfugié et la réinstallation dans un pays tiers n’est possible que pour une fraction des personnes considérées comme des réfugiés.
À la suite d’une vaste couverture internationale des violations flagrantes des droits de l’homme des Ouïghours et d’autres musulmans turcs en Chine, la Turquie a admis, en octobre, 11 Ouïghours qui avaient fui la répression après que la Malaisie a refusé de les renvoyer en Chine et les a libérés de détention.
Acteurs internationaux clés
Les relations entre l’UE et la Turquie sont restées mauvaises et les négociations d’adhésion ont été au point mort. Le Service d’action extérieure de l’UE s’est exprimé sur certaines questions relatives aux droits, notamment la détention de défenseurs des droits de l’homme, de journalistes, de parlementaires et d’universitaires, mais la poursuite de l’accord sur les migrations reste l’objectif principal de l’UE.
En octobre, le gouvernement des États-Unis a obtenu la libération du pasteur américain Andrew Brunson, détenu pendant plus de deux ans pour terrorisme, mais n’a pas dénoncé avec force l’utilisation abusive des lois antiterroristes contre les ennemis et les critiques perçus d’Ankara. Les relations ont également été marquées par des tensions concernant la condamnation par les États-Unis d’un banquier turc pour violation des sanctions américaines, l’application entre août et novembre de sanctions contre les ministres turcs de l’intérieur et de la justice pour la détention de Brunson, la présence sur le sol américain du religieux turc Fethullah Gülen et le soutien américain aux forces kurdes associées du PKK en Syrie du Nord.
La visite d’État du Président Erdoğan en Allemagne, en septembre, avait pour but de rétablir les liens entre les deux pays après les tensions profondes suscitées par la détention arbitraire en 2017 de ressortissants allemands, dont le journaliste Deniz Yücel qui a été libéré en février. Le chancelier et le président allemands ont tous deux fait clairement référence à la détention arbitraire des citoyens turcs et des ressortissants allemands.
Lors de la visite de Erdoğan en janvier à Paris, le Président français Emmanuel Macron s’est exprimé sur la situation des droits de l’homme en Turquie et a affirmé qu’il n’y avait aucune perspective d’adhésion de la Turquie à l’UE pour le moment.
En mars, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a publié un rapport sur les violations de l’état d’urgence, décrivant la détention d’environ 600 femmes et de leurs bébés ou jeunes enfants en relation avec l’association présumée de leurs maris à des organisations terroristes comme une « tendance alarmante ».
En novembre, la Cour européenne des droits de l’homme a statué que la prolongation répétée par la Turquie de la détention provisoire de l’opposant Selahattin Demirtaş violait ses droits et avait pour « objectif ultérieur d’étouffer le pluralisme et de limiter la liberté du débat politique, qui est au cœur même du concept d’une société démocratique ». Le tribunal a ordonné sa libération.
(traduction faite par le Collectif DDH)