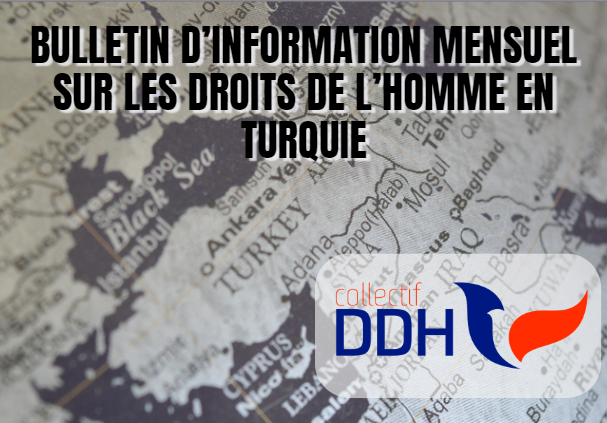HRW dévoile son rapport 2024 sur la Turquie
La traduction par nos soins du rapport 2024 sur les droits humains en Turquie, préparé par Human Rights Watch, est présentée ci-dessous. Pour accéder à la version originale du rapport cliquez ici.
« Turquie, Événements de 2024
Le président Recep Tayyip Erdoğan et son gouvernement de coalition parlementaire dirigé par le Parti de la justice et du développement (AKP) exercent un contrôle important sur les médias, les tribunaux et la plupart des institutions de l’État, écartant régulièrement ou punissant les critiques perçus du gouvernement. Les divisions politiques et les luttes de pouvoir au sein des hautes juridictions turques, ainsi que les rapports croissants de corruption dans l’État et le système judiciaire, ont davantage sapé les droits humains et l’état de droit. Les autorités, y compris les tribunaux, ont continué d’ignorer ou de rejeter les jugements contraignants de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), déclarant la Turquie en violation, ce qui a conduit à la perpétuation de graves violations. Une crise du coût de la vie s’est poursuivie en 2024, avec l’Institut turc de la statistique rapportant un taux d’inflation annuel de 47 % en novembre.
Les élections municipales de mars ont vu le principal parti d’opposition, le Parti républicain du peuple (CHP), réaliser les plus importants gains contre l’AKP d’Erdoğan depuis plus de deux décennies, obtenant 37,8 % des voix au niveau national contre 35 % pour l’AKP et conservant les municipalités d’Istanbul et d’Ankara.
Liberté d’expression
Le contrôle du gouvernement sur les médias s’étend au diffuseur public TRT, à l’agence de presse publique Anadolu Ajansı (Agence Anatolienne), et à la majorité des chaînes de télévision d’information et des médias imprimés, qui sont alignés sur le gouvernement. Les médias indépendants en Turquie opèrent principalement via des plateformes en ligne.
Les autorités ordonnent régulièrement le blocage de sites web et de plateformes ou la suppression de contenus critiques en ligne ou de couvertures négatives concernant des responsables publics, des entreprises, le président et sa famille, ainsi que des membres du système judiciaire. Elles invoquent généralement des menaces non spécifiées pour la sécurité nationale ou l’ordre public ou des violations des droits personnels. Des décisions de la Cour constitutionnelle publiées en novembre 2023 et janvier 2024 ont conclu que deux articles de la loi sur Internet n° 5651 permettant le blocage ou la suppression de contenus pour ces motifs violent le droit à la liberté d’expression ; la décision de janvier a abrogé l’article concernant les violations des droits personnels.
Les tribunaux émettent fréquemment des ordonnances de blocage concernant plusieurs comptes dans un même jugement. Le projet EngelliWeb de l’Association pour la liberté d’expression a annoncé qu’à la fin mars, la Turquie avait bloqué plus d’un million de sites web depuis l’introduction de la loi sur Internet en 2007.
Le 2 août, les autorités turques, sans motifs spécifiques, ont bloqué l’intégralité de la plateforme Instagram pendant huit jours après que le directeur des communications de la présidence a critiqué Meta pour la suppression de messages de condoléances concernant l’ancien chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, tué le 31 juillet.
Les plateformes d’information en ligne Deutsche Welle et Voice of America sont bloquées indéfiniment en Turquie depuis juin 2022 en raison de leur refus d’obtenir des licences. Elles justifient leur refus par le fait que l’obtention de licences les exposerait à des amendes arbitraires et à des sanctions que le régulateur turc des médias inflige régulièrement aux diffuseurs en ligne non alignés sur le gouvernement.
Les journalistes sont régulièrement poursuivis en vertu de la loi antiterroriste turque, ainsi que pour diffamation criminelle et d’autres lois. Les journalistes kurdes sont particulièrement ciblés. En juillet, le procès à Ankara de 11 journalistes kurdes s’est soldé par la condamnation de huit d’entre eux pour « appartenance à une organisation terroriste », chacun étant condamné à six ans et trois mois de prison. Ils ont fait appel des verdicts. Le procès à Diyarbakır de 20 journalistes et travailleurs des médias kurdes pour les mêmes accusations est en cours. Au moment de la rédaction, au moins 21 journalistes et travailleurs des médias étaient en détention provisoire ou purgeaient des peines de prison pour des infractions liées au terrorisme, en raison de leur travail journalistique ou de leur association avec les médias.
Libertés d’association et de réunion
Des milliers de personnes font face à des détentions, des enquêtes et des procès inéquitables pour des accusations de terrorisme en raison de leurs liens présumés avec le mouvement dirigé par le défunt prédicateur basé aux États-Unis, Fethullah Gülen, que le gouvernement considère comme une organisation terroriste responsable de la tentative de coup d’État militaire du 15 juillet 2016. Beaucoup ont subi des emprisonnements prolongés et arbitraires sans recours effectif après leur révocation massive de la fonction publique et du système judiciaire. En juillet, le ministre de la Justice a annoncé que 13 251 personnes détenues ou condamnées, accusées d’être membres du mouvement, restaient en prison.
À ce jour, les autorités turques n’ont pas appliqué une décision clé de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) concluant que la condamnation pour « appartenance à une organisation terroriste » de l’ancien enseignant Yüksel Yalçınkaya, principalement pour avoir utilisé une application mobile appelée ByLock prétendument utilisée par les partisans de Gülen, constituait une application arbitraire de la loi en violation du principe de légalité. Le jugement a également constaté des violations des droits à un procès équitable et à la liberté d’association, et a ordonné à la Turquie de mettre en œuvre des mesures générales pour remédier à ces violations. Environ 8 000 affaires similaires étaient pendantes devant la Cour de Strasbourg au moment de la rédaction. Lors du nouveau procès de Yalçınkaya en septembre, un tribunal local a ignoré la décision de la CEDH et l’a de nouveau condamné sur les mêmes charges.
Les autorités provinciales interdisent régulièrement les manifestations et rassemblements de groupes critiques envers le gouvernement, ignorant souvent les décisions des tribunaux nationaux jugeant ces interdictions disproportionnées. La police procède à des arrestations violentes de manifestants associés à des groupes de gauche ou kurdes.
Attaques contre les défenseurs des droits humains
Osman Kavala, Çiğdem Mater, Can Atalay, Mine Özerden et Tayfun Kahraman, connus pour leur engagement dans la société civile, restent en prison après leur condamnation sur des accusations infondées d’organisation des manifestations de 2013 au parc Gezi et de tentative de renversement du gouvernement. Kavala est arbitrairement détenu depuis octobre 2017, et les autres depuis leur condamnation en avril 2022. La Turquie a ouvertement ignoré la décision de la CEDH ordonnant la libération de Kavala, ce qui a conduit ses avocats à déposer un nouveau recours auprès de la CEDH en janvier 2024 concernant la poursuite des violations de ses droits.
En janvier, l’avocat des droits humains Can Atalay a été privé du siège parlementaire qu’il avait remporté en tant que membre du Parti des travailleurs de Turquie lors des élections législatives de mai 2023, malgré des décisions définitives de la Cour constitutionnelle ordonnant sa libération pour assumer ses fonctions d’élu. L’affaire a déclenché une crise majeure dans le système judiciaire, la Cour de cassation prenant la mesure sans précédent de rejeter deux décisions de la Cour constitutionnelle et demandant même une enquête criminelle sur les membres de cette cour.
En novembre, le gouvernement a retiré un projet de loi sur l’espionnage et s’est engagé à le modifier. Des groupes de défense des droits humains et des journalistes avaient exprimé des inquiétudes quant au fait que le projet de loi visait à élargir la définition de l’espionnage de manière si vague qu’il aurait pu être utilisé pour criminaliser le travail légitime des groupes de la société civile et des médias.
Torture et mauvais traitements en détention
En juillet, le Comité des Nations Unies contre la torture a examiné la Turquie pour la première fois depuis l’augmentation marquée des cas de torture et de mauvais traitements qui a suivi la tentative de coup d’État militaire de 2016. Les observations finales du comité ont exprimé des inquiétudes quant au fait que les allégations de torture et de mauvais traitements se produisent « de manière généralisée, notamment dans les centres de détention », et que, lorsque des poursuites sont engagées, les actes de torture sont « fréquemment requalifiés en d’autres infractions ». Parmi ses recommandations figuraient la fin de la pratique du menottage inversé, largement utilisée par la police, ainsi que la fin « de toutes les extraditions et renditions extrajudiciaires, y compris des individus perçus comme affiliés » au mouvement Gülen. Le comité a également recommandé l’abolition de la peine de réclusion à perpétuité aggravée, qui implique un « isolement de facto » et aucune perspective de libération.
Conflit kurde et répression de l’opposition
La Turquie concentre sa campagne militaire contre le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) avec des frappes aériennes et des attaques par drones dans le nord de l’Irak, où se trouvent les bases du PKK, et dans le nord-est de la Syrie contre les Forces démocratiques syriennes (FDS), dirigées par les Kurdes et soutenues par les États-Unis. Les frappes aériennes turques ont ciblé des infrastructures civiles, mettant en péril les moyens de subsistance et privant des communautés d’électricité et d’autres services essentiels.
En 2024, et au moment de la rédaction, après l’effondrement du régime du président syrien Bachar al-Assad, la Turquie a continué d’occuper des territoires dans le nord de la Syrie, affirmant vouloir se protéger contre l’administration de facto kurde syrienne et les groupes armés alignés sur le PKK. Les autorités turques n’ont pas réussi à mettre fin aux abus commis par leurs proxies de l’Armée nationale syrienne (ANS) et de la police militaire dans les territoires occupés. Les Kurdes et les Arabes dans ces zones ont été soumis à des arrestations arbitraires, des disparitions forcées, des tortures et mauvais traitements, des violences sexuelles et des procès militaires inéquitables. Des milliers de personnes ont été déplacées de force, leurs propriétés, terres et entreprises confisquées.
Des centaines d’activistes kurdes, d’anciens parlementaires, maires et responsables de partis en Turquie sont en prison ou purgent des peines après avoir été condamnés pour des infractions liées au terrorisme, en raison d’activités politiques légitimes et non violentes, de discours ou de publications sur les réseaux sociaux. Cela inclut les anciens co-présidents du Parti démocratique des peuples (HDP), Selahattin Demirtaş et Figen Yüksekdağ, emprisonnés depuis le 4 novembre 2016 ; en mai, ils ont été condamnés à de longues peines de prison malgré les décisions de la CEDH exigeant leur libération immédiate.
En octobre, le leader du Parti d’action nationaliste (MHP), parti d’extrême droite en coalition avec l’AKP d’Erdoğan, a plaidé pour un réexamen de la peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération d’Abdullah Öcalan, chef du PKK, dont il a purgé 25 ans, et même sa possible libération, à condition qu’il appelle le PKK à se dissoudre. La proposition n’a pas abordé le déficit de droits pour les Kurdes, qui est au cœur du conflit de plusieurs décennies entre l’armée turque et le PKK. L’évolution de la situation en Syrie sera également un facteur clé dans toute résolution future du conflit kurde.
En novembre, le gouvernement a destitué deux maires du CHP et cinq du Parti des peuples pour l’égalité et la démocratie (DEM), élus lors des élections de mars, invoquant des procès ou enquêtes pour terrorisme à leur encontre. C’était la troisième fois que la coalition AKP-MHP prenait le contrôle des municipalités kurdes du sud-est, mais la première fois que des maires kurdes du CHP étaient destitués, notamment le maire d’Esenyurt, à Istanbul, qui a été détenu.
Réfugiés, demandeurs d’asile et migrants
La Turquie continue d’accueillir le plus grand nombre de réfugiés au monde. En décembre, 2,9 millions de Syriens avaient un statut de protection temporaire. Le gouvernement turc considère principalement les personnes originaires d’Afghanistan, d’Irak et d’autres pays non européens comme des migrants irréguliers et limite strictement les voies leur permettant de demander une protection internationale, procédant régulièrement à des expulsions massives et publiant des statistiques à ce sujet, tout en effectuant des refoulements sommaires à grande échelle aux frontières.
Les expulsions illégales d’hommes et de certains garçons vers le nord de la Syrie, souvent après les avoir forcés à signer des formulaires de retour volontaire, ont continué. La violence xénophobe contre les Syriens, dans un contexte d’hostilité croissante envers les réfugiés alimentée par des partis politiques utilisant régulièrement cette question dans leur discours, s’est également poursuivie. En juillet, des foules dans la ville de Kayseri ont attaqué des magasins et des voitures appartenant à des Syriens, et une foule à Antalya a tué un garçon syrien de 17 ans.
Droits des femmes
Les conséquences du retrait de la Turquie, par décret présidentiel le 20 mars 2021, de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) se manifestent par l’incapacité continue du gouvernement à prendre des mesures adéquates pour freiner l’incidence élevée de la violence basée sur le genre et des féminicides en Turquie. Bien que le ministre de l’Intérieur ait annoncé en juillet que 166 femmes victimes de violence avaient été tuées par des hommes au cours des six premiers mois de 2024, une enquête menée par l’organisation médiatique indépendante Bianet a estimé ce chiffre à 193.
Orientation sexuelle et identité de genre
Le gouvernement Erdoğan et les partis d’opposition religieux conservateurs utilisent régulièrement un discours politique discriminatoire, équivalent à un discours de haine, à l’encontre des communautés lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) sous prétexte de promouvoir les valeurs familiales. Cela vise à séduire les électorats conservateurs et à alimenter la polarisation sociétale, mettant les personnes LGBT en grand danger. La Marche des Fiertés d’Istanbul a été interdite pour la dixième année consécutive, et de nombreuses villes à travers le pays imposent des interdictions similaires.
Politique climatique et impacts
Malgré la ratification de l’Accord de Paris en 2021 et la préparation d’une mise à jour de ses objectifs faibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les lacunes dans la politique climatique et l’absence de plans pour une transition juste rendent incertaines les capacités de la Turquie à atteindre son propre objectif de neutralité carbone d’ici 2053 ou la date limite de 2026 fixée par l’Union européenne pour l’application de son mécanisme d’ajustement carbone aux frontières.
La Turquie ne s’est pas encore engagée à abandonner le charbon et prévoit d’étendre l’une des plus anciennes et des plus polluantes centrales électriques au charbon du pays, située dans la province de Kahramanmaraş, au sud-est. Les réglementations sur le contrôle de la pollution de l’air ne répondent pas aux normes de l’Organisation mondiale de la santé et ne sont pas entièrement conformes aux normes de l’Union européenne. »