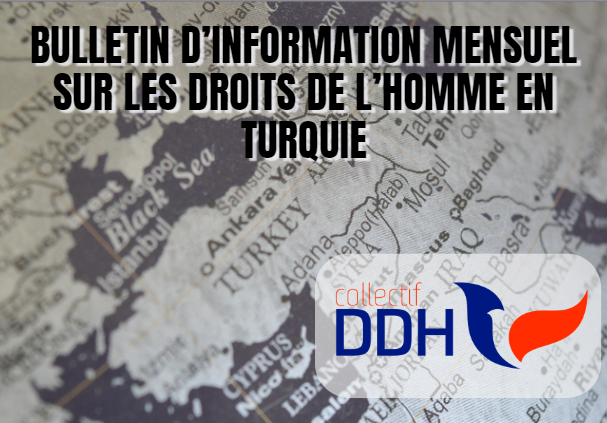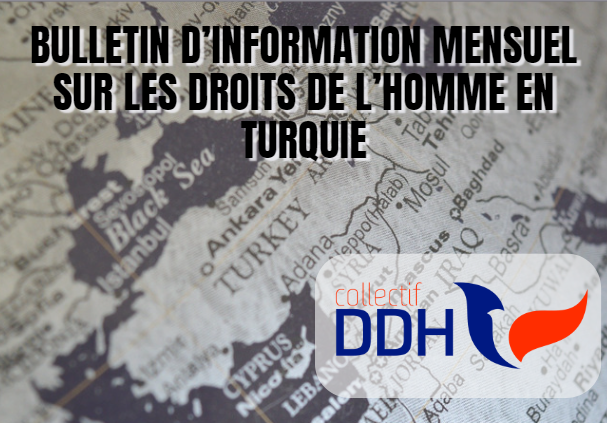Le rapport d’Amnesty International intitulé « Purged beyond return »
Amnesty International a publié en octobre 2018 un rapport, intitulé « Purgés au-delà du retour ? », mettant en lumière la situation des agents public licenciés en Turquie suite à la tentative du coup d’Etat du 15 juillet 2016. Faisant allusion à l’état d’urgence qui avait été annoncé par le gouvernement turc le 20 juillet 2016 et qui, après sept fois de renouvellement, avait pris fin deux ans après le 18 juillet 2018, le rapport soutient que cet état d’urgence a inauguré une période de bouleversements considérables dans la vie publique turque.
Selon le rapport, le gouvernement qui avait, pendant l’état d’urgence, le pouvoir extraordinaire de prendre des décrets-lois a procédé aux licenciements arbitraires d’environ 130 000 travailleurs du secteur public parmi lesquels figurent des enseignants, des universitaires, des médecins, des policiers, des travailleurs des médias employés par le radiodiffuseur d’Etat, des membres des forces armées, ainsi que des personnes travaillant à tous les niveaux des autorités locales et centrales. Le rapport souligne que les licenciements de ces personnes ne comportaient pas de preuves précises ni de détails sur les actes répréhensibles présumés qu’ils auraient commis, mais que ces limogeages se basaient sur une justification généralisée du fait que les personnes concernées avaient des liens avec des groupes proscrits, qu’ils en faisaient partie, qu’ils étaient liés à ces groupes ou qu’ils communiquaient avec eux.
Soulignant l’impact dévastateur des licenciements arbitraires, le rapport évoque que les personnes limogées n’ont pas seulement perdu les emplois qu’ils occupaient, mais, dans certains cas, ils se sont vu totalement refuser l’accès à leur profession, ainsi qu’au logement et aux soins de santé, ce qui les a privés, eux et leurs familles, de moyens de subsistance.
En ce qui concerne le fait que les personnes limogées sont privées, sous l’état d’urgence, de possibilité de recours contre les licenciements et la création en janvier 2017 de la « Commission d’enquête sur l’état d’urgence » pour réexaminer, parmi d’autres, les contestations des personnes purgés, le rapport soutient que ladite Commission n’avait été créée qu’à la suite de considérables pressions internes et internationales. Par ailleurs, considérant la procédure devant la Commission et les décisions prises par celle-ci ainsi que les entretiens qu’a mené Amnesty International avec les personnes licenciées et leur famille, le rapport critique le fonctionnement de la Commission et déduit que la Commission n’a pas été créée pour offrir un recours effectif aux milliers de licenciés du secteur public. Le rapport indique que la combinaison de plusieurs facteurs – notamment l’absence d’une réelle indépendance institutionnelle, la longueur des procédures d’examen, l’absence de garanties nécessaires permettant aux individus de réfuter efficacement les allégations concernant leurs activités présumées illégales et la faiblesse des éléments de preuve cités dans les décisions de licenciement, a empêché la Commission d’offrir un recours contre les licenciements, laissant plus de cent mille personnes sans moyen efficace et opportun d’obtenir justice et réparation.
Le rapport fait remarquer que la Commission ne jouit pas d’indépendance institutionnelle par rapport au gouvernement puisque ses membres sont en grande partie nommés par le gouvernement et peuvent être, eux-aussi, licenciés de leurs fonctions simplement en vertu d’une « enquête administrative » sur la base d’un soupçon de liens avec des groupes proscrits. Ainsi, selon le rapport, les dispositions relatives aux nominations et aux destitutions pourraient facilement influencer le processus décisionnel ; si les membres ne prennent pas les décisions attendues d’eux, le gouvernement peut tout aussi bien s’en passer.
La longueur déraisonnable des procédures de la Commission nuit en outre, selon le rapport, à sa capacité d’offrir un recours rapide et efficace. Le délai d’attente pour les décisions qu’Amnesty International a examinées variait de quatre à dix mois, tandis que de nombreux travailleurs licenciés n’ont toujours pas reçu de réponse de la Commission bien qu’ils aient soumis leur demande plus d’un an auparavant. La Commission n’ayant pas de délai fixe à respecter, le rapport précise que les personnes congédiées éprouvent une incertitude totale quant au moment où ils doivent s’attendre à une réponse. Compte tenu de l’impact important et souvent débilitant des licenciements immédiats sur la vie des travailleurs licenciés du secteur public et de leur famille, le rapport note que ces longs délais d’attente pour une première décision administrative augmente davantage l’inefficacité du recours et mettent les personnes licenciées dans une situation encore plus précaire.
En outre, le rapport souligne que la procédure devant la Commission ne dispose de mesures importantes pour garantir que les demandeurs puissent former un recours effectif, rappelant que les demandeurs ne sont pas autorisés à témoigner oralement, à faire appel à des témoins ou à voir des allégations ou des preuves contre eux avant leur demande. Il ajoute que toutes les demandes font l’objet d’un examen sur dossier, sans qu’il soit prévu d’audiences ni de droit de répondre aux allégations.
Le rapport révèle également, selon l’analyse des décisions de la Commission, que les motifs invoqués par la Commission pour confirmer les licenciements sont dénués de fondement juridique. Il note que les activités licites inoffensives, telles que les interactions mineures avec les banques, les organismes de bienfaisance, les syndicats, les médias, les organisations de la société civile et les écoles perçues comme étant associées à des groupes interdits, sont souvent utilisées comme preuve des « liens » avec ces groupes. Le rapport évoque, en outre, que la Commission considère comme non-pertinent l’argument des requérants selon lequel les activités en question étaient légales au moment où elles ont été menées, pour le motif que les personnes concernées sont réputées avoir mené ces activités en sachant parfaitement qu’elles interagissaient avec des groupes interdits.
D’après le rapport, les décisions rendues par la Commission fournissent des explications identiques dans toutes les décisions et ne contiennent pas d’analyse individualisée en ce qui concerne le lien du demandeur avec des groupes interdits, ce qui rend extrêmement difficile pour les licenciés dont les recours avaient été refusés de former un recours ultérieur devant les tribunaux administratifs.
Rappelant que la Commission a rendu des décisions positives dans un petit nombre de cas, le rapport précise toutefois que la législation sur les réintégrations résultant d’une décision de la Commission ne permet pas une restitution complète. Il met en exergue que les personnes qui ont été congédiées sans motif valable de postes de direction sont rétrogradées, que les universitaires ne peuvent être réintégrés dans l’établissement où ils travaillaient au moment de leur licenciement et ajoute que les membres des forces armées ou de sécurité de certains grades, ainsi que le personnel diplomatique, sont réaffectés dans des « centres de recherche ».
Le rapport déplore qu’un grand nombre personnes licenciées aient accès à une réparation, même si leur recours devant la Commission est accueilli, rappelant que les normes internationales relatives aux droits de l’homme exigent que les victimes de violations des droits de l’homme aient droit à une réparation intégrale, y compris la restitution et l’indemnisation pour le préjudice subi et qu’une indemnisation leur soit accordée pour toute perte, y compris le coût de l’assistance juridique, le préjudice psychologique, le préjudice moral et les occasions manquées. De plus, le rapport juge contraire aux normes internationales relatives aux droits de l’homme la nouvelle loi qui interdit explicitement aux particuliers de saisir les tribunaux administratifs pour obtenir une réparation, ce qui les prive du droit à une réparation viable s’ils estiment que leur régime d’indemnisation est inadéquat ou injuste.
Le rapport conclut que l’état d’urgence de deux ans en Turquie a entraîné de graves violations des droits de l’homme qui ont touché des centaines de milliers de personnes de toutes conditions sociales parmi lesquelles on compte près de 130 000 travailleurs du secteur public qui ont été licenciés arbitrairement et se sont vu interdire de façon permanente de travailler dans le secteur public ou même dans l’ensemble de leur profession. Il souligne également que ces licenciements continuent d’avoir des effets dévastateurs sur les personnes licenciées ainsi que sur leur famille.
Il est soutenu, dans le rapport, qu’après plus de deux ans depuis les premiers licenciements par décret-loi, les personnes licenciées n’ont toujours pas accès à un recours effectif. Le rapport fait valoir que la Commission d’enquête sur l’état d’urgence, soi-disant créée à cette fin, est en fait un timbre d’approbation pour les licenciements arbitraires du gouvernement.
La rapport fait appel finalement aux autorités turques de se conformer aux normes relatives aux droits de l’homme qu’elles prétendent respecter et, pour ce faire, de réintégrer tous les licenciés du secteur public. Il ajoute que dans le cas où des individus sont raisonnablement soupçonnés d’un acte répréhensible, d’une faute professionnelle ou d’une infraction pénale, toute décision concernant leur licenciement devrait être prise uniquement dans le cadre d’une procédure disciplinaire régulière en respectant toutes les garanties de procédure.