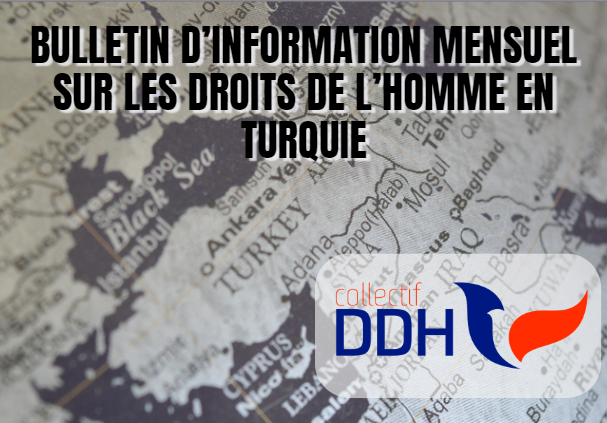« la Turquie demeure un pays extrêmement répressif pour la presse »
Le Rapport annuel 2020 des organisations partenaires de la Plateforme du Conseil de l’Europe pour renforcer la protection du journalisme et la sécurité des journalistes, intitulé « TOUCHEZ PAS À LA LIBERTÉ DE LA PRESSE! LES ATTAQUES CONTRE LES MÉDIAS EN EUROPE NE DOIVENT PAS DEVENIR LA RÈGLE » a été publié. Voici la partie concernant la Turquie:
■Au 31 décembre 2019, 103 alertes actives et 24 alertes résolues concernaient la Turquie, relevant 91 journalistes en détention et quatre cas d’impunité pour meurtre. 18 nouvelles alertes ont été signalées à la Plateforme en 2019 et la Turquie n’a répondu à aucune des alertes de 2019.
■Les alertes de 2019 relevaient notamment des actes de violence à l’encontre de journalistes, l’expulsion de quatre correspondants étrangers, des arrestations arbitraires lors de tentatives de reportage sur des manifestations dans le sud-est de la Turquie et des enquêtes judiciaires pour avoir critiqué l’incursion de la Turquie dans le nord de la Syrie.
■Certains cas parmi les plus notoires ont connu des développements significatifs, illustrant souvent l’arbitraire et l’ingérence politique qui caractérisent le système judiciaire turc. En septembre, la Cour suprême de cassation a annulé la condamnation de 13 anciens journalistes de Cumhuriyet reconnus coupables de faits de terrorisme en avril 2018. L’affaire a été renvoyée devant une juridiction inférieure qui a largement ignoré l’arrêt de la Cour suprême et n’a acquitté qu’un seul défendeur. Auparavant, en mai, la Cour constitutionnelle turque avait rendu des arrêts contradictoires, concluant à la violation par les autorités des droits constitutionnels de certains poursuivis de Cumhuriyet, malgré la nature identique des affaires.
■En juillet, la Cour suprême a également annulé les condamnations des journalistes et écrivains Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak et Mehmet Altan pour tentative de renversement de l’ordre constitutionnel. Tous les trois ont été rejugés en novembre sous des infractions moins graves «d’assistance à une organisation terroriste». Ahmet Altan et Nazlı Ilıcak ont été condamnés respectivement à 10 ans et demi et huit ans et neuf mois de prison. Mehmet Altan a été acquitté. Ahmet Altan et Nazlı Ilıcak ont ensuite été libérés pour la première fois en plus de trois ans. Moins d’une semaine plus tard, cependant, Ahmet Altan a été arrêté à nouveau, le parquet ayant réussi à faire valoir un risque de fuite malgré l’interdiction de voyager dont il faisait l’objet.
■Au moment de la rédaction du présent rapport, les affaires relatives à une dizaine de journalistes étaient toujours pendantes devant la Cour européenne. Idris Sayılğan, un journaliste kurde maintenu en détention provisoire pendant plus de deux ans avant d’être condamné à huit ans et trois mois de prison pour appartenance à une organisation terroriste, a été libéré sans notification préalable le 27 novembre. La Cour européenne doit se prononcer sur la réalité du recours en droit interne alors que son affaire est pendante devant la Cour constitutionnelle turque depuis juillet 2018.
■En Turquie, les journalistes continuent de faire face à des violations de l’État de droit et du droit à un procès équitable, notamment à l’insuffisance de preuves propres à justifier l’arrestation et le placement en détention, à des restrictions d’accès aux avocats de la défense et à la comparution personnelle devant le tribunal, et au recours fréquent à la détention provisoire, en violation de la jurisprudence de la Cour européenne.
■En 2019, le gouvernement turc a déployé des efforts considérables pour convaincre les partenaires internationaux de l’engagement de réformes sérieuses du système judiciaire. Certains éléments d’un «paquet de réformes judiciaires » ont amélioré la situation de certains journalistes, en particulier la levée de l’exclusion des journalistes condamnés à moins de cinq ans du recours devant la Cour suprême, un changement qui a conduit à la libération de plusieurs défendeurs en instance d’appel. Le train de mesures est cependant loin de satisfaire aux demandes les plus urgentes à l’égard de la Turquie formulées par des institutions comme la Commission de Venise, notamment celles de veiller à ce que les journalistes ne soient pas accusés de terrorisme sur la base de leurs écrits et à ce que les autorités justifient de motifs « pertinents et suffisants » pour placer des journalistes en détention.
■En attendant, les pouvoirs du Conseil suprême de la radio-télévision (RTÜK) ont été étendus aux diffuseurs en ligne, désormais tenus de s’acquitter de licences coûteuses. Le manque de précision dans la définition du « radiodiffuseur en ligne » laisse entendre que le RTÜK pourrait entreprendre de contrôler des médias sociaux critiques.
■La volonté des autorités de réglementer les discours et informations critiques en ligne a été mise en exergue en octobre lorsque, dans les 48 heures suivant le lancement des opérations militaires dans le nord de la Syrie, plus de 120 enquêtes ont été ouvertes contre des utilisateurs des réseaux sociaux, dont des journalistes, accusés de propagande terroriste pour avoir publiquement critiqué l’intervention militaire. Ces enquêtes faisaient suite à une déclaration du RTÜK invitant les radio-télédiffuseurs « y compris les médias en ligne » à être attentifs au contenu de leurs reportages, qui ne seraient tolérés s’il était établi qu’ils contiennent de la « propagande émanant d’organisations terroristes dirigée contre l’opération ».
■Bien que, selon les chiffres de la Plateforme, le nombre de journalistes emprisonnés en Turquie ait baissé de 110 à 91 en 2019, la Turquie demeure un pays extrêmement répressif pour la presse. Les autorités et les tribunaux turcs continuent d’assimiler le journalisme critique à une activité terroriste criminelle. Cette tendance ne peut être inversée avec succès tant que perdure la politisation des tribunaux. Les organisations partenaires appellent de toute urgence à la modification ou l’abrogation nécessaire de la législation antiterroriste du pays et à la mise en place de garanties efficaces en faveur de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Les gouvernements européens, le Conseil de l’Europe et l’UE sont instamment invités à accorder la plus haute priorité aux mesures visant à aider les autorités turques à mettre fin à la violation systématique des normes démocratiques et à rétablir la liberté de la presse et l’État de droit.